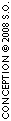Elle s’appelle Nadia. Elle a 14 ans. Polyhandicapée, elle est presque tout le temps recroquevillée sur son lit d’hôpital, dans la même position bizarre, douloureuse.
J’arrive près d’elle : elle agrippe aussitôt son regard au mien, et, plus un seul instant, ne le décrochera. Je lui dis quelques mots, surtout pour cacher mon trouble : non seulement je vois très vite qu’elle ne peut me répondre, mais en outre rien ne m’indique qu’elle comprenne mes paroles. De plus en plus désemparé, je lui chante quelque chose, je lui joue un peu de musique… Pendant toute notre rencontre, elle ne bougera pas, ou alors par convulsions, de manière désordonnée, irrationnelle, indéchiffrable. Elle n’exprimera rien. Ou plutôt, elle n’exprimera rien que la plénitude d’une humanité brute et nue, sans aucune particularisation, sans aucune variation qui serait le signe d’un sentiment, d’une pensée, d’un désir. Ce n’est pas qu’elle n’élabore pas, au-dedans d’elle-même, des sentiments, des pensées : personne ne pourrait le contester, tant son regard crie l’être humain qu’elle est — le problème est précisément qu’il ne crie que cela ! Mais elle ne les exprime pas, pas en tout cas d’une manière telle que quelqu’un puisse les déchiffrer (moi, mais aussi bien les infirmières, les médecins, ses parents…)
L’immense mystère qui s’accroche de tout son être à mon regard est un abîme insondable de souffrance, que je suis même incapable d’imaginer : comment vivre, penser, désirer sans jamais trouver le moyen de partager cela avec d’autres humains ? Dire qu’il y en a qui, en plus, sont sourds et aveugles…
Pourquoi toute cette souffrance ? Il n’y a pas d’explication. En un sens, c’est rassurant : dans ce domaine, expliquer, c’est toujours minimiser. L’explication mettrait une distance, et la souffrance en face paraîtrait moins grande. Inévitablement, l’explication est trahison.
Jamais le voyageur ne recherche de telles rencontres. Mais lorsqu’il se retrouve face à cette souffrance d’autrui, cessant tout bavardage intérieur, qu’il se tienne devant elle, s’il le peut, qu’il se laisse gifler par ce vent glacé : il paraît que ça la désarme. Pour ma part, je n’y parviens toujours pas. Impossible même de fuir : cette souffrance me rattrape toujours. Mais je crois que cela, d’une certaine manière, est rassurant. Tragique, désespérant — et rassurant.
Car c’est un signe que je suis bien un homme, si la souffrance d’autrui finit toujours par m’écraser.